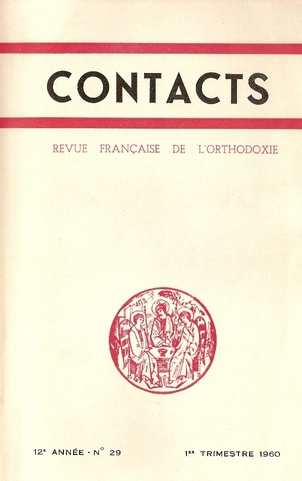N° 29 – 1er trim. 1960
Liminaire
A propos de la connaissance et du dogme
Nous sommes heureux d’offrir aux lecteurs de « Contacts », la traduction française de la communication que le professeur Edmund Schlink a présentée cet été à Rhodes, durant la session du Conseil œcuménique des Églises.
Luthérien, le professeur Schlink aime et connaît, — d’autant mieux —, l’Orthodoxie. Sa communication jalonne un dialogue (triangulaire en réalité, car les catholiques en constituent aussi un des partenaires) qui ne peut qu’aider l’Église orthodoxe à prendre conscience de sa richesse, donc de son service.
Lorsque le professeur Schlink souhaite qu’une communion féconde s’établisse entre le christianisme occidental et le christianisme oriental, c’est la Tradition même qu’il suggère, — cette réception ecclésiale de la Vérité dans le Saint-Esprit —, car c’est elle qui suscite — et dépasse — les traditions historiques qui l’expriment et parfois, dans leurs limitations, la trahissent…
L’Orthodoxie est — mais n’est pas seulement — l’Orient chrétien. Qu’on lise par exemple la fin de l’étude profonde et neuve consacrée par Mme Behr-Sigel au destin spirituel de Gogol : la démarche de celui-ci comme il le remarque lui-même, est « protestante » ; elle évoque celle d’un Luther, sa dialectique du désespoir et de la grâce. Pourtant, elle débouche sur le mystère ecclésial, si typiquement orthodoxe, — ou catholique. L’ontologique, ici, ne s’oppose pas à l’existentiel : il en constitue le contenu, la vivante profondeur où l’énergie divine pénètre et transfigure l’être entier de l’homme. Rencontre existentielle et communion ontologique ne seraient-elles pas comme les deux dimensions de la personne ?
* * *
Peut-être les pages les plus importantes que nous offre le professeur Schlink — et dans lesquelles, à travers la tradition orientale, il décèle la Tradition même de l’Orthodoxie — sont-elles celles qu’il consacre à la structure doxologique du dogme.
C’est sur ce point, si important de nos jours où le langage, y compris celui de la doctrine chrétienne, semble mourir, que nous voudrions nous attarder un peu.
* * *
La Vérité, pour l’Orthodoxie, comporte un aspect d’enseignement, une « règle de foi » dont la connaissance, dès les temps apostoliques, était exigée des candidats au baptême. Pourtant la Vérité n’est pas un système doctrinal, mais une Personne, ou plutôt une Trinité de Personnes, qui devient pour nous source de vie. Elle ne se sépare pas de l’Eucharistie — dans tous les sens du terme — mais l’intériorise en contemplation.
« Celui qui prie vraiment est théologien » répètent, depuis Évagre, les spirituels orthodoxes. « Le mystère de l’incarnation du Verbe, dit Maxime le Confesseur, contient en soi la signification de tous les symboles et énigmes de l’Écriture, ainsi que le sens caché de toute la création sensible et intelligible. Mais celui qui connaît le mystère de la Croix et du Tombeau, connaît aussi les raisons essentielles de toutes choses. Enfin, celui qui pénètre encore plus loin et se trouve initié au mystère de la Résurrection, apprend la fin pour laquelle Dieu a créé toutes ces choses au commencement ». (1)
Il ne s’agit donc pas de spéculer, mais d’aimer Dieu « de toute son intelligence », comme le Christ nous l’a demandé. L’intelligence aussi doit nous aider à nous transformer, en se transformant elle-même au feu de l’Esprit. « C’est la présence de l’Esprit-Saint qui fait d’un érudit un théologien » dit s. Syméon, et s. Ephrem conseille : « Avant toute lecture, prie et supplie Dieu pour qu’il se révèle à toi ». Aimer Dieu avec son intelligence n’est donc pas « expliquer » la Révélation, c’est offrir humblement à sa lumière notre faculté d’expliquer, pour qu’elle meure dans l’eau du Baptême et renaisse dans l’« intelligence du Christ » comme faculté d’invoquer.
C’est pourquoi les Pères distinguent souvent la raison raisonnante (dianoia) qui, dans la conception tripartite de la nature humaine, relève de la psyché, et l’esprit, (noûs) qui s’identifie partiellement au pneuma paulinien. Il ne faudrait pas durcir, ou plutôt « substantialiser » cette distinction qui risquerait alors de conduire à une gnose intellectualiste (ce fut, on le sait, la tentation d’un Clément d’Alexandrie, d’un Origène, d’un Évagre). Le salut concerne l’être entier. La « chair » et l’ « esprit », pour s. Paul, ne sont pas deux « substances », mais deux attitudes, deux choix existentiels de l’homme total qui l’ouvrent soit à la frénésie d’anéantissement des puissances mauvaises, soit à la plénitude ontologique de l’Esprit de Dieu. Le corps, ici, peut-être spirituel, et l’esprit charnel.
C’est dans cette perspective qu’il nous faut entendre la distinction patristique de la dianoia et du noûs. Ce sont là, pour l’homme, deux manières d’utiliser son intelligence, ou plutôt de s’engager lui-même dans sa totalité d’être intelligent : « Si ton œil est clair, tout ton être sera dans la lumière ».
La dianoia, c’est l’homme se tournant vers le monde et l’objectivant pour se l’approprier. Elle participe donc de l’ambiguïté des « tuniques de peau » qui, depuis Philon, symbolisent notre condition déchue (donc contre-nature) mais stabilisée, utilisée et finalement assumée par Dieu lui-même. Et donc, par la conversion — metanoia —, elle tend à devenir noûs, c’est-à-dire ouverture et transparence au Saint-Esprit. Déchue, la dianoia sépare et oppose ; elle construit autour de l’individu, en vampirisant la création divine, un monde dont il constitue le centre. On pourrait dire, en paraphrasant Héraclite, que ceux qui dorment du sommeil du péché ont chacun un monde dans lequel il s’emprisonne, dans lequel aussi il emprisonne l’univers loin de Dieu qui pourtant le crée et le remplit. Le noûs, au contraire, c’est l’être personnel devenant intelligent en découvrant Dieu comme centre. Et Dieu lui fait découvrir à travers le cosmos liturgique, le monde véritable où les choses sont autant de paroles du Verbe fleurissant en beauté sous le souffle de l’Esprit, où l’autre existe aussi intérieurement que moi-même, où le Christ ne cesse de triompher de l’enfer, celui d’abord que je suscite, afin de m’offrir, pour aimer, l’amour incréé qui par lui, et dans l’Esprit, vient du Père…
Mortifiée à nouveau par la pénitence, nourrie par l’eucharistie qui ne cesse de renouveler sa participation au noûs Christou et sa grande onction par l’Esprit, comment l’intelligence pourrait-elle désormais se séparer de l’amour et de la louange ? « La science, ici, devient amour ». L’homme — être intelligent — le devient pleinement dans une connaissance existentielle, — doxologique et eucharistique. Et cette connaissance, au sens biblique, est la rencontre nuptiale, dans l’Esprit, entre la personne humaine et son Sauveur rayonnant de gloire. C’est pourquoi elle « réside dans le cœur », alors que la raison « réside dans le cerveau ». Le cœur, en effet, pour la spiritualité orthodoxe comme pour la Bible, n’est nullement l’organe de l’affectivité. (Et même ce rapport si banal que le langage de l’Occident moderne établit entre le cœur et le sentiment ne peut avoir qu’une origine symbolique, il constitue comme un résidu du symbolisme plus vaste dont nous parlons). Le cœur signifie — et constitue réellement — le centre personnel de l’homme total, la profondeur (comme celle de Dieu inobjectivable) de la personne humaine qui englobe et transcende l’être entier de l’homme, son visible et son invisible. Que cette profondeur s’ouvre réellement dans le cœur physique nous suggère une sorte de physiologie de la vie totale, un symbolisme vrai du corps humain dont peut-être les savants chrétiens devraient tenir compte…
La connaissance authentique — celle qui transforme l’homme entier en « re-connaissance » — exige donc « l’union de l’intellect et du cœur » : afin que l’intelligence devienne l’expression, et comme l’incandescence, d’un engagement personnel, d’une rencontre personnelle avec le Dieu vivant; afin qu’elle découvre à la racine même de notre vie l’énergie divine de l’eucharistie: car le corps déifiant du Seigneur fait germer dans la profondeur du nôtre « l’homme intérieur du cœur » auquel nous devons, de toute notre intelligence, faire attention.
Le dogme, dans l’Orthodoxie, sera donc un « symbole » au sens le plus réaliste, une parole matérielle où s’involue toute la plénitude et qui relève, comme la vie entière de l’Eglise, de la catégorie du « mystère ».
Offrant par toute sa réalité « doxologique » le « mystère caché en Dieu avant tous les siècles », l’Église n’en situe intellectuellement les frontières que sous la contrainte du danger. La définition dogmatique est proprement un horos, une limite, qui sauvegarde la possibilité de la louange et de l’union à Dieu. L’Église dogmatise pour rester orthodoxe, c’est-à-dire source de la vraie gloire : pour permettre à l’homme cette juste glorification qui le fait participer à la gloire. L’expérience de la lumière incréée corrélative à la rencontre du Christ constituait, depuis s. Jean et s. Paul, le cœur de la spiritualité chrétienne. Elle n’a reçu d’expression dogmatique qu’au 14e siècle lorsque des interprétations rationalistes prétendirent la mettre en cause.
L’hérésie, le plus souvent, rationalise le mystère. Le dogme, pour écarter un commode agencement de concepts, doit recourir, apparemment, à des concepts semblables, surtout ceux de l’ontologie. Les Pères de Nicée comprirent que le seul langage de l’Écriture ne permettrait pas d’éviter des ambiguïtés qui feraient le jeu des ariens. Ils eurent donc recours à une notion ontologique, ils affirmèrent que le Fils est homoousios, de même essence que le Père. Mais qu’est-ce donc, sinon le nécessaire dessin ontologique de la certitude première de notre foi : Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant.
L’ontologie ici devient symbole et comme matière d’une fulgurante vision. Car, pour sauvegarder sa structure doxologique, son ouverture au Mystère plus qu’ontologique de la Trinité, le dogme orthodoxe brise les limitations conceptuelles et la notion même d’essence par l’antinomie et la négation.
L’antinomie pose deux affirmations en « être » (Dieu est mais il est aussi, ou le Christ est mais il est aussi) qui sont également et simultanément vraies pour la foi, mais contradictoires pour la raison. L’antinomie suprême, ébauchée par homoousios, réside dans le dogme de l’Unitrinité, qui unit et distingue la diversité absolue et l’identité absolue. « Gloire à toi, ô Dieu » et « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit » constituent les deux termes doxologiques de cette équation dogmatique. La raison est donc systématiquement écartelée, et l’abîme ainsi ouvert ne peut qu’implorer l’abîme de la « philanthropie » divine. Trois égale Un, Un égale Trois : « Dieu est amour ». Deux en Un : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique… ». L’antinomie crucifie la raison pour l’ouvrir à la révélation qui la transfigure.
L’apophase — la négation — fait de même en soulignant la transcendance du Dieu vivant par rapport aux notions en « être » ; elle achève d’allégoriser l’ontologie, elle la « désobjective », la « déconceptualise », nous montre en elle le vivant contenu, voire l’instrument, de l’existence personnelle en sa plénitude. Apophatique, le dogme refuse de saisir Dieu : il permet à Dieu de nous saisir, ou plutôt de nous emplir par l’intérieur même de notre liberté. « Les concepts créent des idoles de Dieu, le saisissement seul pressent quelque chose. » Quelqu’un plutôt. Le dogme le plus apophatique est sans doute celui de Chalcédoine qui confesse « un seul et même Christ, Fils, Seigneur, le Monogène, qui se fait connaître en deux natures sans mélange, sans changement, indivisiblement Inséparablement » (en grec le préfixe négatif a sonne quatre fois, comme avec une révérence sacrée). Le comment de cette union échappe à notre raison : suggéré négativement, il nous « étonne », nous «saisit », nous éveille à l’adoration.
Ainsi le dogme impose l’impossible à l’intelligence. Il la tue dans son extériorité qui sépare et oppose. Mais « ce qui est impossible à l’homme est possible à Dieu ».
Et Dieu vivifie l’intelligence, il la pénètre de sa lumière incréée, il la rend capable de distinguer et d’unir pour suggérer le mystère de la Personne…
Écoutons Grégoire de Nazianze — Grégoire le Théologien — railler ceux qui voudraient rendre la Trinité intelligible : « Que sont-ils donc pour parler de telles choses ? A peine peuvent-ils savoir ce qui est à leurs pieds; ils ne savent supputer ni le sable de la mer ni les gouttes de la pluie, ni les jours du temps, et les voilà qui pénètrent dans les abîmes de la Divinité, qui rendent raison de la nature ineffable et incompréhensible » (2).
Texte admirable, ou le mystère des choses fait écho à celui de Dieu. Les Cappadociens, méditant sur le caractère inépuisable de toute essence créée, ont en quelque sorte, pour reprendre le vocabulaire d’un Heidegger, affirmé l’être insondable des choses contre le concept qui, de chaque chose, fait un « étant ». Ils ont ainsi empêché l’expression théologique de se refermer sur elle-même, de cimenter, pour notre confort intellectuel et notre déconfort spirituel, un monde d’ « étants » intelligibles. Un monde qui relèverait de l’érudition ou de la jurisprudence de ceux qui jamais n’ont laissé couler dans leurs doigts, un jour d’hiver, le sable froid de la mer, qui jamais n’ont médité sur la pluie douce et humble, qui jamais n’ont éprouvé dans l’angoisse ou la joie, « les jours du temps ».
Pour la Grèce pré-socratique la doxa était cette glorification à la fois poétique et pensante par laquelle le poète philosophe posait les choses dans la lumière. Souvenir, peut-être, d’Adam « nommant » les vivants au Paradis.
Par son Incarnation, le Verbe a récapitulé non seulement la Parole historique, mais aussi le logos cosmique.
Il a restauré la plénitude brisée de l’être en la situant dans une autre plénitude, la sienne: celle, méta-ontologique, de la personne. C’est dans cette perspective que le christianisme ancien et Byzance ont élaboré, par toute la vie de l’Eglise dont le dogme est un aspect, le prodigieux langage de la Doxa. Aujourd’hui que meurt le parler ou plutôt le partage des hommes parce qu’il s’est séparé de l’être (depuis la chute sans doute) et qu’il n’a pas su trouver la personne (par quelle impardonnable absence du christianisme ?), aujourd’hui donc nous devrions nous tourner vers ce témoignage doxologique. Le dogme doxologique de l’Orthodoxie d’une part nous prosterne devant le « cercle de silence » qui entoure le trône du Dieu vivant. D’autre part, épousant le mouvement même de la théophanie, il nous révèle le secret des êtres et des choses, ce centre en chacun où la densité devient transparence, où l’être créé participe à la gloire divine. Il nous conduit moins à des constructions intellectuelles qu’à une altitude doxologique que l’ascèse intériorise et que la pensée devrait sobrement déchiffrer. Par l’arbre de la Croix — axe de notre louange —, il prépare la transformation de l’univers en Église, c’est-à-dire en Buisson Ardent.
Olivier Clément
(1) Centuries gnostiques I, 66. PG 90, col. 1108 AB.
(2) Or, 31, S, PG 36, col 141 B.
Sommaire
Liminaire. A propos de la connaissance et du dogme
[p. 1-9]
Olivier Clément
La signification de la Tradition orientale pour le monde chrétien
[p. 10-21]
Dr Edmund Schlink
Le message spirituel de Gogol. Suite et fin
[p. 22-37]
Elisabeth Behr-Sigel
Pâque
[p. 38-43]
Nicolas Gogol (traduit par Victor Balalaeff)
Chronique
• Images grecques
– V. Destin d’un petit chat
[p. 44-48]
– VI. Nostalgia
[p. 48-49]
Léon Zander
• Souvenirs religieux de Tunisie
[p. 50-54]
Nadine Fuchs
• La situation en Roumanie
[p. 54]
Olivier Clément
Bibliographie
• Les saints moines d’Orient– R.P. Placide Deseille
[p. 55-57]
• Le monde et la personne – Romano Guardini
[p. 57-59]
• Transfigurer le temps – Olivier Clément
[p. 59-63]
• Le Messager Orthodoxe – A.C.E.R.
[p. 63-64]