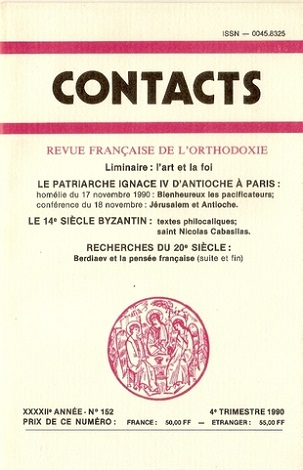N° 152 – 4e trim. 1990
Liminaire
Dans la démarche de l’artiste, dans la démarche de tout homme qui s’arrache au somnambulisme du quotidien, il y a recherche, creusement, interrogation. Ou, plus simplement, et d’un mot qui résume tout, éveil. Les vieux ascètes disaient que le plus grand des péchés est l’oubli : devenir opaque, insensible, tantôt affairé et tantôt pauvrement sensuel, incapable de s’arrêter un instant dans le silence, de s’étonner, de chanceler devant l’abîme, qu’il soit d’horreur ou de jubilation. Incapable d’aimer, d’admirer, de se révolter. Incapable d’accueillir les êtres et les choses. Insensible aux sollicitations secrètes, constantes pourtant, de Dieu. L’art ici nous éveille. Il nous approfondit dans l’existence. Il fait de nous des hommes et non des machines. Il rend nos joies solaires et nos blessures saignantes. Il nous ouvre à l’angoisse et à l’émerveillement. L’émerveillement, parfois, de l’originel, du « paradisiaque », l’innocence du plaisir, qui se fait gratitude d’être. C’est la première beauté, « le vert paradis des amours enfantines, L’innocent paradis plein de plaisirs furtifs ». Les enfants se parlent dans le noir, un visage de jeune fille se reflète dans le miroir lunaire. « Tout ce qui nous reste du paradis, disait Dostoïevski, ce sont les rires d’enfants et le chant des oiseaux .»
Mais de saint Augustin aux psychanalystes on nous a appris que le ver est dans le fruit, la perversité dans l’enfance. Le paradis est à la fois proche et perdu, et c’est cette proximité interdite qui est atroce. L’existence est nostalgie, tout est pourri par la mort et, pour oublier celle-ci, l’homme invente des paroxysmes où la beauté se fait meurtrière : « L’éphémère ébloui vole vers toi, chandelle. / Crépite, flambe et dit : « Bénissons ce flambeau… » »
La deuxième beauté manifeste cette blessure, cette fascination, ce cri : « la beauté sera convulsive ou ne sera pas », le flamboiement des corps s’éteint dans la torture, le meurtre devient l’un des beaux arts, la subjectivité contradictoire, asphyxiée, refait inlassablement les mêmes gestes de destruction.
Parfois, enfin, des éclairs jaillissent d’ailleurs, d’une intériorité transsubjective. La neige qui recouvrait les apparences fond, les masques tombent, un visage se dévoile, les yeux étoilés de larmes, le cœur profond s’ébranle, chaque chose semble un miracle. Troisième beauté, dont le front est marqué non d’une étoile mais d’une croix. Pour qui ne voit pas celle-ci, la décharge — comme on dit une décharge électrique — est trop forte, c’est la folie, peut-être le suicide, — suicide baptismal, qui sait ?
Pourtant, s’il y a la recherche, la blessure peut-être mortelle, il y a aussi la révélation. On compte plusieurs révélations, je le sais, et seul Dieu comprend le mystère de ces « économies » qui parfois semblent se contredire. Pour moi le Christ « récapitule » toutes ces « visites du Verbe », et c’est de la révélation chrétienne que je veux parler.
L’homme reçoit celle-ci dans la foi et la gratitude. Eucharistie veut dire « merci ». Dans sa profondeur, l’Église n’est rien d’autre que la « merci » de Dieu accueillie par le « merci » de l’homme, de quelques hommes qui entrent dans « l’état d’offrande » du Christ au nom de l’humanité tout entière et du cosmos…
L’art proprement liturgique — icônes (et donc aussi fresques, mosaïques, espace architectural), hymnographie et sa musique, symboles et gestuelle de la célébration – a pour but d’accueillir la révélation, de rendre sensible à celle-ci d’une sensibilité de tout l’être c’est-à-dire du cœur profond : où l’intelligence et le désir trouvent leurs racines et le creuset de leur transfiguration.
L’art proprement liturgique a pour sens d’être un support de contemplation, la possibilité de connaître Dieu par une certaine beauté, celle, dit Denys l’Aréopagite, « qui suscite toute communion ». J’inverserai volontiers la formule en disant : la beauté que suscite toute com-munion (dont le fondement et la forme suprême sont justement la révélation). Dans cet art, il est moins question du « sacré » que du « saint ». Le « sacré » est une catégorie statique, et qui divise : il y a le sacré et il y a le profane. Le « saint » est un dynamisme de sanctification ; le « profane » en réalité est profané : il faut le libérer du mensonge, de la possessivité, de l’objectivation pour qu’il s’illumine au grand soleil de la résurrection, pour qu’il soit sanctifié. Le « saint » est le rayonnement d’une personne : en Christ le Dieu « trois fois saint » s’est fait visage, donc en Christ je peux voir en Dieu tout visage.
L’artiste ici, qui n’est parfois qu’un artisan, assume une diaconie ecclésiale. Il ne peut être qu’un homme de foi, qui fait sien le credo par la prière, l’ascèse, l’ouverture au grand fleuve de vie de la vraie Tradition, qu’on pourrait définir comme fidélité à la Parole sans cesse actualisée par l’Esprit. L’artiste, ou l’artisan, essaie de se dégager de sa subjectivité close, d’entrevoir son modèle par une contemplation trans-subjective, de transmuer par la Croix les « passions » ambiguës et passives en une com-passion créatrice.
Mais alors, dit l’homme d’aujourd’hui, le peintre d’icônes, ou le compositeur qui met la musique au service de la Parole, ne sont pas libres. Qu’entendons-nous donc quand nous disons : liberté. D’évidence, il faut répondre : être libre, c’est faire ce qu’on veut.
Mais qui veut ? Est-ce l’homme déchiré, contradictoire, — « Je ne fais pas le bien que j’aime mais je fais le mal que je hais » — l’homme livré aux pulsions de son inconscient, aux modes, aux grandes forces de la société et du cosmos ? La beauté créée par cet homme, s’il s’aventure dans le domaine liturgique, ne risque-t-elle pas d’être une beauté de possession ?
N’est-il pas plus libre, vraiment libre peut-être, l’homme libéré, pacifié, délivré de l’angoisse par la foi, du narcissisme par la prière, l’homme simultanément ouvert et unifié dans la lumière de la grâce, l’homme qui, loin de se vouloir démiurge, s’accepte comme créature image de son Créateur ?
C’est pourquoi l’art liturgique ne va pas sans règles, sans « canons » qui constituent comme son ascèse. Qui précisent la disposition des scènes, l’individualité des visages par respect du plus humble fidèle qui doit pouvoir reconnaître ses amis. La perspective inversée, la frontalité, le rôle essentiel du visage, partie du corps la plus transparente à la personne, autant d’indications qui permettent justement à la beauté de susciter la communion et d’être suscitée par elle.
Mais cette ascèse, dans la vie comme dans l’acte créateur, tout en donnant une humble valeur au travail répétitif de l’artisan, permet au grand créateur d’être libre d’une liberté qui ne se sépare plus de l’amour. Que l’on pense aux chefs-d’œuvre de cette tradition : le Christ de Sopotchani, sur lequel Yves Bonnefoy a écrit des pages décisives, la « Descente aux enfers » de Chora, à Constantinople, ou la fluidité de Roublev…
L’Occident a connu un art liturgique assez semblable : en peinture jusqu’à Cimabue et Duccio, en musique jusqu’à Schütz et Monteverdi. Au-delà, des surgissements sporadiques : la paix d’une scène peinte par Georges de La Tour ou gravée par Rembrandt, une Sainte Face de Rouault…
Mais la vocation de l’Occident a été autre : dans la divino-humanité christique, il a exploré l’humain. Peut- être en réaction contre une pauvre sécularisation du divin, qui résultait — qui sait ? — de la séparation d’avec l’Orient chrétien, de la perte du sens « apophatique » de Dieu, de ces représentations trop humaines du Père, source de la divinité (dans l’art de l’icône, la représentation du Père est interdite).
Ainsi l’Occident a-t-il été conduit vers un art non de la transfiguration mais de l’exode, d’exploration aussi de cet éros et de ce cosmos qu’abandonnait un christianisme piétiste et moralisateur. L’Orient a sauvé le secret du visage, l’Occident scruté la splendeur du corps, et retrouvé le sacré cosmique, surtout quand se sont ouverts à lui les arts des « primitifs » et de l’autre hémisphère spirituel de l’humanité, qui va de l’Inde au Japon par le Tibet et par la Chine. Au-delà de l’art abstrait, mais grâce à lui, surgit une poétique du sensible. Demain, peut-être, des visages : car au bout de l’humain le plus décomposé, au bout de l’enfer pointe la lumière, puisque le Christ ne cesse de descendre en enfer et que le nihilisme occidental est peut-être aujourd’hui le seul lieu possible de sa résurrection…
L’art liturgique de l’Orient pourrait discrètement aimanter cette évolution. Certains, parmi les orthodoxes purs et durs, voudraient faire de l’art de l’icône un art « sacré » qui, par contraste, disqualifierait le reste de l’art. Mais on peut y voir aussi une immense bénédiction et le germe d’un divino-humanisme : ce qui s’est ébauché aux XIIIe et XIVe siècles avec la « renaissance des Paléologues » et Théophane le Grec, ce qui se cherche aujourd’hui chez un Sorin Dumitrescu à Bucarest, ou un Elias Zayat à Damas…
Dans la sphère occidentale, qui devient aujourd’hui planétaire, hormis les sobres exigences de l’art proprement liturgique, la création ne peut être qu’entièrement libre, d’une liberté violente, tragique, peut-être blasphématoire. Le « blasphème » reste une relation avec Dieu, ce que l’indifférence, ce sommeil de l’âme, ne saurait être. Le « blasphème » doit être ressenti par les chrétiens comme une question qui leur est durement posée. La Dernière Tentation du Christ, un roman puissant de Kazantzakis, un film médiocre et sanguinolent de Scorsese, pose une vraie question, décisive pour la nouvelle évangélisation de l’Europe : la relation du Christ et de I’éros.
Quant aux œuvres dites « post-chrétiennes » qui puisent dans l’imagerie de nos Églises, elles nous appellent à un grand effort d’approfondissement ; dans l’Esprit Saint, rien ne peut être « post-chrétien », seulement plus mystérieusement, plus intérieurement chrétien…
La vraie réponse chrétienne au « blasphème » comme à l’indifférence (apparente) de l’époque, serait d’abord, me semble-t-il, le développement d’un art liturgique rayonnant, comme une haute montagne où le ciel se condense dans la neige lumineuse qui, elle-même, donnera naissance aux ruisseaux, aux rivières, aux prairies et aux vergers. Ce serait ensuite l’essort d’un art du narthex, un art des « passeurs », des « stalkers » (au sens que Tarkovsky donnait à ce mot) entre ce très doux rayonnement d’une part, la beauté et l’horreur du monde de l’autre. Je pense par exemple à Dostoïevski, à Péguy, à Bernanos, à T.S. Eiiot, Pasternak ou Soljénitsyne… Comme si venait le moment où la liberté doit choisir : ou bien de se désagréger, ou bien de pressentir, au fond même de l’enfer, dans la lumière de certains regards — celui de la Vierge de Vladimir ou celui de Mouchette — qu’elle a besoin d’être libérée…
Olivier Clément
Sommaire
Liminaire. L’art et la foi
[p. 241-246]
Olivier Clément
Bienheureux les pacificateurs
[p. 247-251]
Ignace IV
Jérusalem et le Patriarcat d’Antioche
[p. 252-262]
Ignace IV
Textes philocaliques
[p. 263-273]
Jacques Touraille
Nicolas Cabasilas : Portrait d’un hésychaste
[p. 274-279]
Marie-Hélène Congourdeau
Berdiaev et la Pensée française
[p. 280-298]
Olivier Clément
Correspondance : à propos de l’ordination des femmes
[p. 299-303]
Elisabeth Behr-Sigel
Bibliographie
· La foi vivante de l’Église – Constantin Yannaras
[p. 304-306]
· Sauver la création – Ignace IV
[p. 306-307]
· La Mère de Dieu dans l’Eglise orthodoxe – Alexis Kniazeff
[p. 308-312]
· Prière, Esprit Saint et unité chrétienne – P. Matta El-Maskine
[p. 312-316]