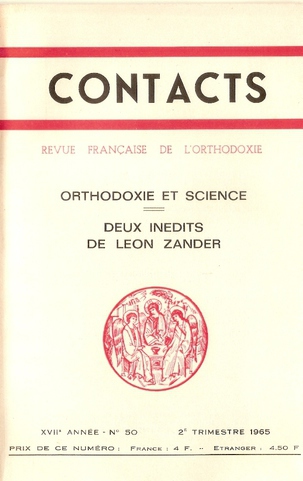N° 50 – 2e trim. 1965
Liminaire
Quelques réflexions sur la science et la « science des sciences ».
On dit volontiers que la science est « sacrilège » ; qu’elle a « désacralisé » l’univers et l’âme de l’homme et détruit les images naturelles et psychologiques de Dieu.
Mais tournons-nous vers la grande théologie orthodoxe. Nous trouvons une négation encore plus radicale dans l’approche de l’absolu. Рour saint Grégoire de Nysse, toute image relative à Dieu devient une idole mentale. Les concepts que nous formons selon notre entendement créent des simulacres de Dieu au lieu de nous révéler Dieu lui-même. En se voyant contraint de renoncer à savoir ce qu’est Dieu, l’esprit crucifié pressent que Dieu est, au-delà même de l’être, l’existence personnelle absolue. Dieu n’est pas l’être suprême en série avec les autres êtres, ni même l’être, il est « celui auquel il appartient de ne pouvoir être comparé à rien ».
Lorsque la théologie apophatique s’affaiblit, se mitige, se trouve insérée dans une « théologie des concepts », tout progrès de la science risque d’apparaître comme un danger pour la foi. Pour la théologie apophatique au contraire, il devient purificateur. Marx et Freud sont des «idoloclastes», des démystificateurs du reste mystifiés par leur désir non seulement de comprendre, mais de réduire.
Le mystère du Dieu vivant ne se situe pas sur le plan de la science comme un interdit, comme une barrière. Il se situe dans une autre dimension qui transcende le domaine de la science et à laquelle nous ne pouvons nous éveiller que par une transformation ontologique, en nous déprenant du sensible et de l’intelligible par cette «purification de l’esprit» qui nous détache du monde et de notre propre psychisme pour nous ouvrir, dans la profondeur, à la révélation de l’Inconnaissable. La science, située à son juste plan, ne peut que nous aider à nous détacher des images et des concepts pour transcender le monde vers une tout autre rencontre. L’intelligence humaine, arrachée au cosmos qu’elle rationalise et maîtrise, tremble de solitude et d’angoisse dans cet espace qu’elle constitue elle-même, transparence à rien mais qui le deviendra à Dieu si l’homme s’y prosterne en silence.
La théologie négative culmine à cette rencontre, elle est moins technique d’ascèse qu’ouverture à la personne, inépuisable dans son geste même de don. Tout ce que je puis savoir d’un homme ne remplacera jamais pour moi le risque de la confiance. Toute la science du monde ne remplacera jamais pour moi le risque de la foi, cette adhésion personnelle à une présence personnelle, au-delà du monde que la science transforme en un vaste désert, désert du moine, du seul tendu vers le Seul, monos pros monon.
La science ne détruit pas seulement les « images de Dieu », mais aussi les « images de l’homme ». Tout l’humanisme occidental a vécu d’une image de l’« homme naturel » qui s’accordait à la nature et que la natuге portait.
Maintenant, la nature n’a plus de visage pour la science. Elle se résout en un océan d’abstractions extra-sensorielles, l’homme ne peut plus s’en faire une vision harmonieuse, cette admirable maquette où se condensait la musique des sphères. Et loin qu’elle le porte, il s’en découvre responsable. Sorti de la nature maternelle, il doit l’organiser au lieu de s’abandonner à elle. Tout devient conscient, volontaire, tout se fait par la médiation de la science et de la technique. Le cordon ombilical est rompu entre l’homme et la terre-mère. Le choix définitif se prépare : désintégrer ou transfigurer.
Or cet homme que la nature n’enveloppe plus, sa nature propre aussi lui échappe, corrodée par les analyses de la science. La vieille définition de Boèce, reprise par la scolastique latine, que la personne est un individu d’une nature intellectuelle, — un « animal raisonnable », que peut-elle encore signifier après les réductions de la biologie, de la sociologie, de la psychanalyse ? L’affirmation de la même théologie scolastique (et de certains Pères), que l’image de Dieu en l’homme réside dans les facultés supérieures de sa nature, l’intelligence et la volonté, que vaut-elle devant la science et les techniques de concentration que nous enseigne l’Orient non-chrétien et qui nous apprennent à nous dissocier de nos volitions et de nos pensées ?
Ainsi, au moment même où l’homme perd l’enveloppement de la nature, il semble lui-même se résoudre en « agrégat impermanent » d’éléments cosmo-biologiques sociaux et psychologiques que les sciences de l’Occident analysent et conditionnent et que les sciences de l’Orient non-chrétien résorbent dans un vide impersonnel, — celui-là même peut-être que découvre notre physique quand elle efface la frontière entre la matière et l’énergie, puis entre l’énergie et «quelque chose» qui n’est plus exprimable qu’en formules mathématiques — qu’en intelligence impersonnelle.
Ici encore, il semble qu’il n’y ait pas d’autre issue pour le christianisme que la notion orthodoxe de la personne — la personne humaine apparaissant, à la lumière de la théologie trinitaire, comme une réalité absolue à laquelle on ne peut s’ouvrir que par des négations — une anthropologie apophatique correspondant, grâce à la divino-humanité du Christ, à la théologie apophatique. La personne humaine ne peut se définir par aucune partie de sa nature, ni par le corps, ni par l’âme, ni même par l’intelligence contemplative. Elle transcende radicalement cet intellect qui semble maintenant en continuité avec la matière. Comme le Dieu vivant dont elle est l’image, elle est le tout autre, l’incomparable. Elle n’est pas assemblage, lois, concepts, statistiques, mais cette unicité à la fois transparente et inconfusible qu’on ne peut connaître qu’en se donnant, dans le risque de la rencontre: comme la foi, rapport personnel où l’on s’engage tout entier.
Ainsi la science, en voulant réduire la personne à ce qui n’est pas elle, nous contraint à la situer à sa vraie place, au-delà de toute science et de toute objectivation, dans l’unité — diversité du Corps du Christ et des flammes de la Pentecôte.
Dans la découverte, par une transformation ontologique, du Dieu vivant qui vient à la rencontre de l’homme et lui révèle sa propre dimension personnelle, c’est-à-dire communiante, dans le champ de cette communion la nature elle aussi révèle des profondeurs qui échappent nécessairement à la science.
Toute la nature se situe en effet pour le chrétien dans la perspective de la rencontre. Dieu a créé la nature pour l’homme, pour qu’elle soit la chair de leur amour et qu’elle devienne eucharistie : Bible cosmique où l’homme doit déchiffrer chaque chose comme une Parole subsistante, afin d’offrir eucharistiquement à Dieu les logoï des créatures.
La chute a constitué une véritable catastrophe cosmique; par le péché de l’homme, la corruption et la mort ont asservi le monde et c’est cette nature enténébrée, mêlée de mort, énucléée et objectivée que notre science étudie.
Mais une autre connaissance s’offre au chrétien : le Christ a récapitulé l’univers et l’a secrètement recréé. Cette nature libérée, ensoleillée par la croix de lumière comme par un soleil intérieur, elle vient à nous dans l’Eglise, et surtout dans l’eucharistie. Depuis l’Ascension, la nature est secrètement devenue le corps glorieux du Christ que l’Esprit nous « re-présente » dans les « mystères ».
Le saint est celui qui déchiffré cette réalité paradisiaque et « parousiasque » des choses, de l’univers créé par Dieu, en Dieu et pour Dieu, asphyxié par le mal, recréé par le Christ, douloureux et glorieux à la fois car il chante en Christ la gloire de Dieu mais implore des hommes, de leur liberté créatrice dans le Saint Esprit, sa délivrance définitive. L’art déjà, et toute création authentique, pressentent cette réalité sans toujours savoir discerner l’aspect eucharistique et l’aspect nocturne des choses ; et nous pressentons que ce domaine de l’art, parce qu’il décèle la profondeur — celle de la fête ou relie de l’angoisse ou l’une et l’autre étrangement confondues comme chez Van Gogh — implique une connaissance irréductible à celle de la science. La « contemplation de la nature » de la grande ascèse orthodoxe transcende plus encore le plan de l’investigation scientifique, et sait réaliser, elle, le partage mystérieux de la lumière et des ténèbres. Elle relève d’une illumination eucharistique de la plus humble sensation, dans la perspective parfaitement réaliste, ontologique, des « sens spirituels »; accueil, purification, déchiffrement « pléromatique » de ces « qualités secondes » que Descartes méprisait au profit du mouvement et de l’étendue, seuls quantifiables. Qu’importe que la fleur ou le roc se ramènent pour la science à un jeu extrasensoriel de vibrations, à un tourbillon d’énergie : leur forme imprimée dans ce tourbillon nous révèle l’action créatrice de Dieu, la présence de la Trinité, eût dit la théologie anté-nicéenne ou Maxime le Confesseur ; car le Père est la source de l’être, le Logos de la limite intelligible et l’Esprit fait le devenir de la fleur ou la densité du rocher…
Ainsi le saint percevant la transfiguration secrète des choses y collabore en Dieu : car, assumées par le Christ, elles doivent l’être par les hommes, afin de devenir ce pour quoi elles furent créées : le lieu, le moyen et la célébration de l’amour.
C’est dans cette perspective qu’il faut situer le miracle. Si la nature telle que la science l’étudie était la véritable nature, alors le miracle serait une sorte d’absurdité (à laquelle ont achoppé les savants chrétiens d’Occident aux 17e et 18e siècles : si Dieu est parfait, disaient-ils, les lois qu’il a établies le sont aussi, il est donc contradictoire qu’il veuille les bousculer). Certes, la nature déchue a été stabilisée par Dieu. Mais les lois où elle s’est figée témoignent à la fois de la sage patience du Créateur et, de la déchéance de la créature, de cette « vanité » à laquelle, selon saint Paul, nous l’avons soumise. Dans sa réalité première, paradisiaque (refoulée, emprisonnée au fond des choses par la chute), la nature était un pur dynamisme vers Dieu — elle était miracle. Le miracle, ce bondissement du créé vers sa source, cette vivante transparence à la lumière divine, constitue donc, pourrait-on dire, la vraie nature des choses. C’est pourquoi seul le Christ, parce que son humanité sans péché ne défigure ni n’asservit, peut nous révéler la vérité sur la nature : sa présence, comme le feu dans la glace, faisait fondre les lois « infra-naturelles », rendait aux choses et aux êtres autour de lui, leur dynamisme naturel. Et la « contemplation de la nature » du chrétien, contemplation in Christ, continue et même élargit, par la grâce du Saint Esprit, cette action sacerdotale du Dieu-homme. Le saint est le véritable Orphée qui apaise les fauves (ils sentent en lui, disait saint Isaac, le parfum de l’Adam paradisiaque) et qui peut guérir les malades voire ressusciter les morts. Dans le miracle émerge la nature véritable, le paradis retrouvé dans une fulgurance eschatologique ; l’instant, au sein même du temps de la corruption et de la mort, est comme, saisi par la Parousie.
Il est donc absurde d’affirmer que la vision scientifique du monde est incompatible avec la notion traditionnelle du miracle. Non seulement il s’agit de deux niveaux différents de l’être — celui de l’extériorité et celui de la profondeur — mais la science authentique, quand elle renoncera à «maudire» certains faits, devra reconnaître et cerner le miracle.
Le chrétien doit par conséquent lutter pour garder à la science sa démarche spécifique — qui est d’ouverture et de recherche nue, sans métaphysique de contrebande. Loin d’imposer des limites à la science, il doit exiger d’elle une quête plus exigeante. Il sait en effet qu’il n’a rien à redouter, au contraire, d’une science toujours plus ouverte à la complexité et à la profondeur de la nature et de l’homme. Le chrétien doit en appeler de la science close à la science ouverte, c’est-à-dire de la science morte à la science vivante, et il doit par son propre effort, par son propre engagement dans la quête scientifique, contribuer à la maintenir ouverte et vivante. Que le monde soit la création de Dieu, que l’énergie divine pénètre et cherche à transfigurer l’univers, que l’homme soit, à l’image de Dieu, une existence personnelle inobjectivable, cela ne signifie nullement que la science doive trouver des bornes, mais simplement que le réel se présente à elle comme inépuisable et qu’elle doit rester interrogation et mouvement. La science authentique est une sorte d’épectase dont nous voyons bien aujourd’hui qu’elle désigne l’insondable. Cet abîme, selon le libre choix de l’homme, sera l’angoisse du non-sens ou le réceptacle de la foi, mais certes la science comme telle ne le comblera pas. Une science qui voudrait se clore en constituant son objet en globalité achevée ne serait qu’un découpage aveugle (ou volontairement aveuglé) dans l’indéfinité du réel, découpage où s’exprimerait en fait le choix métaphysique du savant, sa négation de la transcendance. Une science ouverte n’a rien à dire de la transcendance mais, pour ceux qui ont des yeux pour voir, elle la désigne par son dynamisme même, par son insatiable inachèvement.
Nous n’avons plus la naïveté de croire que le savant enregistre la réalité comme une plaque photographique. L’activité de l’observateur est sélective, l’homme observe à son propre niveau de réalité, c’est toujours à travers lui-même qu’il observe. Les Pères nous enseignent que l’homme est l’hypostase du cosmos : la nature est toujours non seulement vue mais qualifiée par une personne. La qualité de l’observation dépendra donc de la qualité du regard. Un obsédé sexuel ne verra dans la mystique que de la sexualité ratée. Un observateur plus unifié, plus libéré, y notera au contraire l’expression créatrice d’une énergie inconnue dont la sexualité est une manifestation, un symbole, et non pas la vérité et la norme. Ou encore, pour utiliser la vieille typologie hindoue, Hegel relu par un shudra donne le marxisme ; relu par un brahmane (tel Boulgakov dans la Tragédie de la Philosophie), sa pensée se révèle abâtardissement spéculatif de la théologie trinitaire…
Ainsi un vrai savant est celui qui adopte à l’égard du réel une attitude d’ouverture active et respectueuse. Au lieu de projeter sur le réel l’ombre de ses préjugés et de ses limites et de découper soigneusement cette ombre, il efface son individualité et l’avance d’intelligibilité qu’il consent à l’objet est un éclairement d’amour. C’est pourquoi le chrétien peut vivre sa recherche scientifique comme une ascèse de dépouillement et de charité. Sachant que la véritable objectivité est finalement la discipline d’une rencontre, rendant gloire simplement parce que le monde est intelligible et la science possible.
La responsabilité cosmique du chrétien s’exerce fondamentalement d’une manière spirituelle, par les transmutations et les bénédictions de l’Eglise intériorisées et prolongées par la prière personnelle. Mais cette « spiritualité de réintégration » dans le Logos doit pénétrer aujourd’hui les vastes domaines que l’investigation scientifique ne cesse d’ouvrir au logos humain.
Les choix, du reste, se précisent. Nous nous bornerons à deux exemples. L’un est celui de l’écologie. Ou la terre, enfiévrée par la chimie, écrasée par des machines trop lourdes, traitée comme une simple matière première, deviendra stérile, ou l’homme respectera les rythmes de la vie. Après le viol moderne qui fut prépondérance de l’espace sur le temps, la science de la conservation des sols, la réhabilitation de l’arbre, cet élément «inutile», «contemplatif», de la nature, ébauchent, dans la soumission de l’espace au temps de la vie, un nouveau pacte avec le fondamental. L’humble et nécessaire rapport de nourriture, donc de filiation, qui nous lie à ta terre, posera de plus en plus le dilemme de l’exploitation stérilisante ou du respect, voire de l’amour. Il faudrait dans ce domaine reprendre les intuitions du P. Boulgakov dans sa Philosophie de l’Economie : ouvrage fondamental construit sur le thème de la nourriture-mystère de mort (tuer pour manger) et de vie (par le rayonnement de l’eucharistie).
L’autre exemple concerne ce qu’on appelle, encore, par habitude, la matière. Aujourd’hui, dans ce domaine, la science, qu’elle le veuille ou non, pose le problème de l’étoffe même du monde. Effacer, comme nous le rappelions tout à l’heure, la frontière entre l’énergie et un réseau de relations mathématiques en continuité avec l’intelligence, c’est faciliter l’inscription dans la matière du chaos de l’âme tournée vers le bas, c’est vouer la matière à la désintégration. Mais il est peut-être une autre voie : des physiciens chrétiens pourraient entreprendre d’illuminer la « matière » en insérant, dans le champ même de leur effort scientifique, cette « contemplation de la nature » que pratiquent tes hésychastes : ainsi, à travers leur « contemplation scientifique », la nature profonde, déjà sauvée en Christ, s’éveillerait au sein de la nature déchue. Les structures mathématiques du réel, au lieu d’être des idées inversées, vues dans la perspective du néant, s’ouvriraient aux Idées divines.
Certes, il faut être extrêmement prudent. Il en est de l’œuvre de transfiguration comme de l’eucharistie qu’elle prolonge. C’est un mystère de la foi, visible seulement aux saints, éclatant parfois en miracles, mais dont la portée ne se révélera pleinement qu’à la Parousie. Les alchimistes prétendaient transformer le plomb en or, mais l’or lui-même est ambigu : matière saturée de lumière et témoignage de l’âme transfigurée, ou métal de lucre et de sang. Les chrétiens ne sont pas des alchimistes d’un nouveau genre : ils n’ont pas à rêver d’une science totale qui, dès ici-bas, transfigurerait l’univers, réaliserait comme une eucharistie évidente qui fascinerait « ceux du dehors ». Toute ambition titanique est à rejeter. Reste que le chrétien, œuvrant sans réticence dans tous les domaines de la science, luttant pour garder ouverte la recherche et la fécondant des intuitions que peut lui donner une « conscience eucharistique », reste que le chrétien étant simplement chrétien dans son labeur de savant prépare, invisiblement le plus souvent, la transfiguration de l’univers. Nous n’avons pas à bouder la science : nous devons nous y engager pour mieux servir l’unique Logos qui rend passible toute connaissance et que toute connaissance désigne. Dans ce service, nous trouverons notre croix, car les puissances démoniaques usent aussi de la science. L’œuvre du savant chrétien sera ainsi, à la fois, d’exorcisme et d’adoration. D’exorcisme, car plus la science dégage l’homme de la nature, plus sa liberté pervertie risque de la défigurer et de la détruire. D’adoration, car plus notre intelligence scrute le ciel et la terre, plus nous découvrons, nous chrétiens, qu’ils veulent se remplir de la gloire de Dieu ; plus nous pressentons que cette immense exploration, de l’atome à la nébuleuse, n’a d’autre fin que de faire rayonner jusqu’aux rivages du néant la lumière que les saints voient jaillir de l’eucharistie. En nous le cosmos liturgique s’approche du monde, déchu, si douloureusement beau pourtant car la Sagesse pour le maintenir s’y exile, attendant de notre science priante et de notre prière savante que se rétablisse la circulation de la gloire. En nous, secrètement, sinon dans le signe du miracle, le monde déchu s’élève déjà jusqu’à l’eucharistie, l’exil de la Sagesse s’achève. Et l’on se demande parfois : s’il se trouvait des savants capables de prier non à côté, non à l’écart de leur recherche, mais dans l’œuvre même de leur intelligence, alors, en vérité, ne serait-ce pas, au lieu de la désintégration de la matière, un pas décisif vers sa réintégration eucharistique, un pas décisif vers la Parousie ?
Sommaire
Liminaire
[p. 89-99]
Olivier Clément
L’alternative inconsistante : la science ou la religion
[p. 10-138]
C. Andronikof
Deux inédits de Léon Zander
– Orthodoxie et catholicisme
[p. 139-148]
– La philosophie religieuse russe et le marxisme
[p. 149-161]
Chronique
• A l’Institut de Théologie Orthodoxe de Paris
[p. 162-163]
Jean Tchékan
Bibliographie
• Les Ages de la vie spirituelle – Paul Evdokimov
[p. 164-166]
• L’expérience chrétienne dans la Bible – Jean Corbon
[p. 167-168]